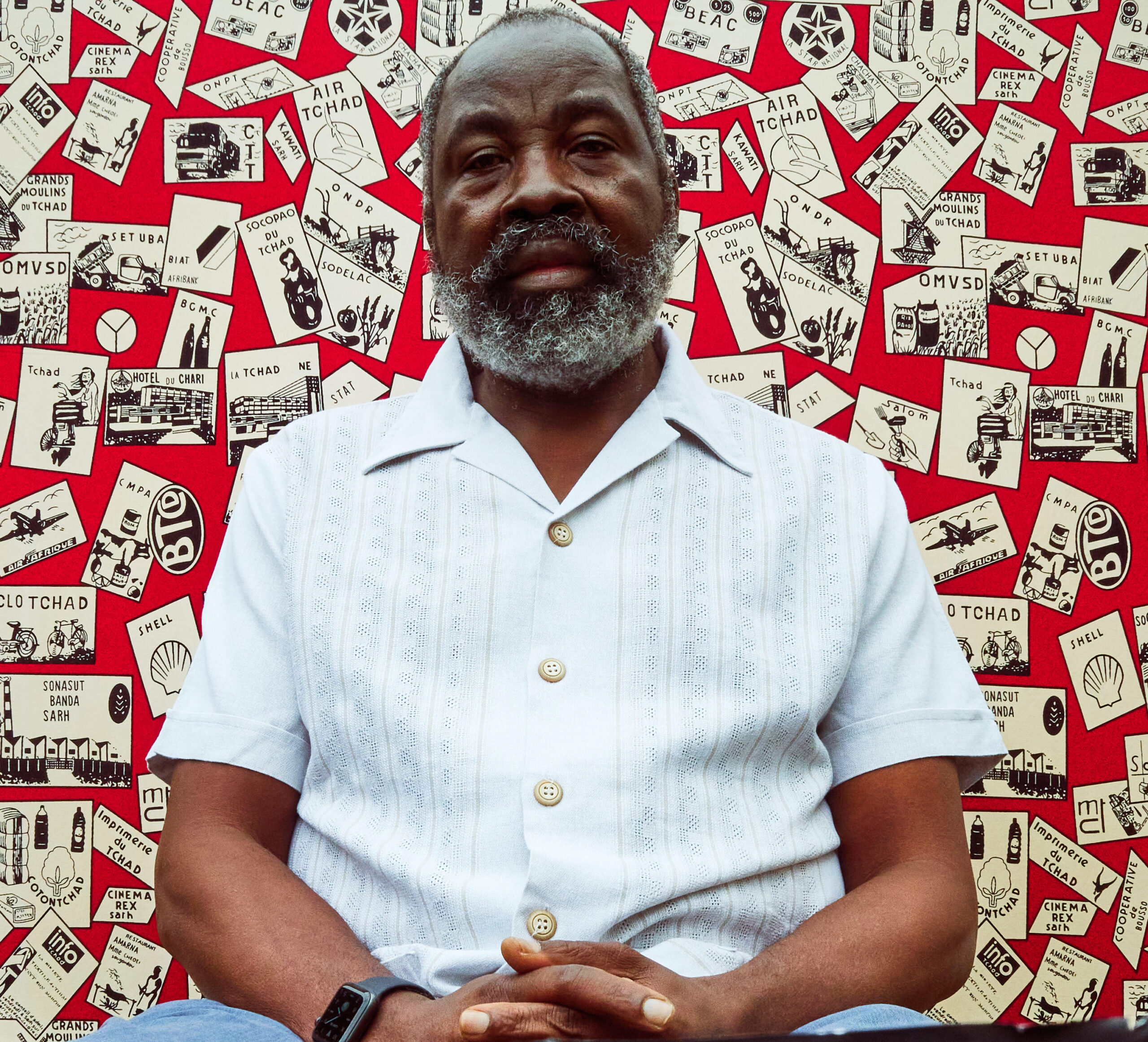L’IFES en tant que ministère para-ecclésiastique pour l’évangélisation des étudiants
“Change the university and you will change the world.”
CHARLES HABIB MALIK
LEBANESE PRESIDENT OF THE THIRTEENTH SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
La collaboration des ministeres specialises et des églises : une necessite
Les oeuvres chrétiennes qu’on nomme parfois « para-ecclésiastiques » ont la particularité de se consacrer à des ministères « spécialisés » tels que l’évangélisation des étudiants, des prisonniers (voir *Aumônerie des prisons), des handicapés (voir *Aumônerie des personnes handicapées), l’alphabétisation, la traduction de la Bible, le développement social et économique (voir *Action sociale), la *formation théologique (voir *Institutions de formation théologique), l’*éducation, la production de la littérature (voir *Édition, écrit), etc.
Pour ce qui est de l’évangélisation des étudiants, ces ministères spécialisés, dont Campus pour Christ (ou Agapè), les Groupes bibliques universitaires (GBU), les Navigateurs, Jeunesse en mission et bien d’autres, sont généralement bien acceptés par les Églises évangéliques. Plusieurs de ces mouvements ont fait leurs preuves par une contribution remarquable à la diffusion de l’Évangile. De nombreuses personnes se sont converties (voir *Conversion) par le témoignage de ces mouvements à l’université. De nombreux responsables d’Églises et de missions évangéliques reconnaissent avoir reçu leur vocation lorsqu’ils étaient impliqués dans ces ministères, en tant qu’étudiants.
Cependant à cause du caractère souvent interdénominationnel des oeuvres para-ecclésiastiques, certaines Églises locales et dénominations sont réservées à leur égard. Dans le noble désir de préserver leur pureté doctrinale et surtout d’exercer un contrôle sur les étudiants (y compris financier), elles s’implantent sur les campus. C’est ce qui conduit parfois à la prolifération des initiatives dénominationnelles sur les campus universitaires, sans véritable collaboration entre évangéliques. Cette prolifération de dénominations en milieu universitaire est loin d’être une approche viable dans la durée. Les universités utilisent souvent le prétexte du désordre créé par la prolifération des groupes évangéliques pour fermer les campus au témoignage chrétien.
Vu la nature particulière de l’université, la meilleure stratégie, pour les évangéliques, serait de collaborer dans une concertation permanente. Les dénominations peuvent travailler en concertation avec les ministères spécialisés, qui ont acquis de l’expérience, de la compétence et un savoir-faire. Dans cette collaboration, les oeuvres para-ecclésiastiques se doivent de rendre compte aux Églises, sous des formes et formats appropriés. La plupart du temps, le fait d’inviter quelques responsables d’Églises évangéliques locales à faire partie de leur conseil ou à prier régulièrement pour les étudiants, le fait d’informer régulièrement les Églises évangéliques de ce qui se passe effectivement parmi les étudiants, aide à créer des canaux de communication et un climat de confiance. Un tel climat contribue à porter à son maximum l’utilisation des ressources et des dons dans l’accomplissement de la mission. On observe que là où une bonne collaboration entre dénominations et ministères spécialisés existe, le ministère parmi les étudiants se porte mieux.
Les initiatives chrétiennes qui cohabitent sur les campus devraient éviter d’entrer en compétition les unes avec les autres. Chaque organisation a souvent une spécialité ou une compétence particulière que d’autres organisations n’ont pas nécessairement. L’essentiel est que les étudiants découvrent le Christ, le suivent et soient formés. Le but de la présence à l’université est l’expansion du royaume de Dieu et non la construction de l’empire d’un ministère particulier, par des compétitions contre-productives pour le témoignage chrétien à l’université.
The best strategy is one that consists of students themselves reaching their peers. This is why Christian students must be the primary actors in evangelism on campus, since they live together, developing friendships, discussing, and debating.
La collaboration est en elle-même une stratégie d’évangélisation, car elle permet de communiquer aux étudiants non chrétiens les valeurs de l’amour chrétien en rendant visible l’unité chrétienne sur le campus. L’un des points de critique fréquemment formulés par les étudiants non chrétiens est l’image de cette fragmentation incompréhensible parmi les chrétiens. Quand des groupes chrétiens différents travaillent en harmonie sur le campus, ils contribuent à éliminer au moins l’une des barrières qui empêchent certains étudiants de prêter attention au message du salut en Jésus-Christ.
L’evangelisation des Etudiants en tant que Priorite Strategique
Plus près de nous, l’IFES, en tant que mouvement para-ecclésial, a pour principale motivation l’amour de Dieu pour les étudiants. Dans cette optique, l’attitude de l’Église envers les millions d’étudiants peuplant la planète peut s’inspirer de celle de Jésus-Christ : « En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger » (Mt 9.36).
L’université est une institution stratégique. C’est là que la jeunesse est équipée et façonnée. C’est souvent à l’université que les décideurs sont formés et que leur vocation est fixée pour le reste de leur vie. Dans beaucoup de pays du monde, les étudiants constituent l’élite de leur société. Ils ont un potentiel d’influence considérable. C’est au sein de cette élite formée que des dirigeants et décideurs économiques, politiques, scientifiques et religieux sont recrutés. En devenant chrétiens durant leur période de formation universitaire, ils ont le temps et l’occasion de développer une pensée chrétienne. Formés comme disciples de Jésus-Christ, ils deviennent capables de faire des choix de vie judicieux, en consacrant leur vie et leur vocation au service du Seigneur. Si les universités avaient été structurées à l’époque des *apôtres comme elles le sont aujourd’hui, il n’y a pas de doute que des personnes comme l’apôtre Paul y auraient intentionnellement investi du temps, y prêchant la Bonne Nouvelle aux étudiants. Son rapport au monde intellectuel, en particulier à l’Aréopage, pourrait témoigner de sa conscience du caractère stratégique de l’élite intellectuelle.
Face à la sécularisation croissante des universités et le recul significatif de la présence chrétienne sur les campus, les protestants évangéliques devraient s’investir particulièrement sur ce terrain. Le témoignage chrétien en milieu universitaire est aujourd’hui une nécessité. Ce témoignage doit être engageant et profond. Il s’agit d’aller au-delà des incursions éclairs et d’une présence superficielle. La présence évangélique doit être telle qu’elle soit capable d’entrer en dialogue véritable avec les idées véhiculées dans les universités et qui animent les idéologies et visions du monde non soumises à la seigneurie de Jésus-Christ. C’est dans une telle perspective que l’évangélisation des étudiants aura un impact perceptible sur l’évolution de certaines pensées non bibliques, qui sont élaborées dans les centres de recherche des universités.
Les defis specifiques de l’evangelisation des etudiants
Les projets évangéliques d’évangélisation des étudiants font généralement face à plusieurs difficultés. Tout d’abord se pose la question du libre accès à l’université. Les universités, du fait de la laïcité, se ferment de plus en plus à la présence du religieux en général et du christianisme évangélique en particulier. Cette situation ne présente pas, humainement parlant, de perspectives d’amélioration immédiates. La difficulté, née d’interprétations tendancieuses de la notion de laïcité et de la peur de certaines formes et expressions religieuses, semble être d’ailleurs commune à l’ensemble de l’espace francophone, qui subit l’influence des mêmes idées. Ce refus d’ouverture des universités aux évangéliques se trouve parfois accentué, dans certains pays, par la prolifération anarchique des dénominations chrétiennes sur les campus, d’une manière qui ne prend pas toujours en compte la spécificité du monde universitaire. À la longue, cette prolifération des dénominations constituera un obstacle majeur à la présence chrétienne évangélique sur les campus, y compris dans des pays encore ouverts ou tolérants au témoignage chrétien à l’université.
Une bonne proportion d’étudiants, notamment en Occident, est insatisfaite du christianisme. Leur insatisfaction vient très probablement de l’image que le christianisme leur projette : une religion négative, qui met l’accent sur les interdits et qui n’affirme pas suffisamment de choses positives comme la jouissance, la célébration, la communion et la beauté. Dans un contexte fluide, dominé par le pluralisme, un christianisme qui brandit la doctrine et les interdits comme un drapeau devient suspect. Les étudiants de la génération actuelle ne s’opposent pas radicalement à la religion, mais ils questionnent radicalement la façon dont le christianisme est présenté et vécu dans la société. En général, ils sont d’une génération qui veut s’impliquer et participer, mais trouvent que la structure ecclésiastique, très institutionnalisée, voire hiérarchisée et rigide, ne répond pas à leur désir. Ils se sentent attirés vers les expériences spirituelles à émotions fortes et vers certaines formes de spiritualité.
Les universités, de plus en plus sécularisées, influencent le monde par des idées, des idéologies et des visions du monde qui sont souvent opposées au christianisme. L’idéologie du nouvel athéisme, par exemple, est intentionnellement véhiculée parmi les étudiants, notamment en Occident. Les étudiants sont constamment exposés à des conférences et littéralement bombardés de littérature et de publicités en tout genre, qui visent à les influencer. En plus de ces campagnes orchestrées, la culture actuelle, qui influence les étudiants, se caractérise par le changement rapide, la perte des repères et des valeurs traditionnelles, le relativisme, le matérialisme et la satisfaction immédiate. Les étudiants ont tendance à accorder davantage d’importance à leur individualité et se polarisent sur leur désir d’insertion dans la vie professionnelle. En réaction à l’individualisme ambiant, on note chez eux un fort désir de communauté. Ce désir de vivre en communauté se manifeste par la mobilité et la connectivité. D’où le succès extraordinaire des réseaux sociaux virtuels. Beaucoup d’étudiants vivent dans une incertitude par rapport à l’évolution de la société, dans une confusion liée à l’absence de repères, de certitudes et de sens. Cette absence de sens est entretenue et nourrie par l’insatisfaction causée par le chômage grandissant, la fragilisation des liens familiaux, la compétition outrancière et l’absence de modèles de vie attirants dans la société.
L’insuffisance en compétences humaines capables de témoigner efficacement dans le milieu universitaire représente une autre limitation à l’évangélisation efficace des étudiants. L’université est un champ de mission très particulier. Il est bien différent des autres champs de mission. Tout d’abord par sa composition : l’université regroupe, pour l’essentiel, des intellectuels, c’est-à-dire des personnes impliquées dans une réflexion approfondie. Ensuite, par sa méthode de formation : elle forme les étudiants au questionnement et, dans une certaine mesure, à la découverte du monde par une remise en cause permanente. Ce questionnement, mis en oeuvre par une démarche critique, peut être radical et passionné. Peu de croyants évangéliques sont formés à travailler dans un tel environnement. On a tendance à aborder l’université à la manière dont on s’adresserait à un auditoire ordinaire. La reproduction, sur le campus, des méthodes d’évangélisation de l’Église locale ne fonctionne pas toujours. La démarche de l’apôtre Paul, lorsqu’il cherche à évangéliser des Athéniens très cultivés, montre que cette catégorie de personnes nécessite une démarche particulière. La structure de son discours tout comme son contenu témoigne de la prise en compte de cette spécificité de son auditoire (Ac 17.16-34). La tendance anti-intellectuelle véhiculée par certaines formes de spiritualité évangéliques à la mode constitue un handicap au témoignage en milieu universitaire. Une telle tendance décourage le bon usage de l’intelligence et amplifie une culture du mysticisme inadaptée à l’évangélisation du monde universitaire. Les étudiants veulent souvent qu’on accompagne la présentation de la foi d’un raisonnement.
A Christianity that waves the doctrinal rules and restrictions around like a flag becomes suspicious. Students of this generation are not necessarily opposed to religion, rather they radically question the way in which Christianity is presented and lived in society.
Se pose aussi la question de la particularité de l’évangélisation de la classe d’âge des étudiants et de leur culture. Les étudiants sont de plus en plus jeunes. Ils sont donc caractérisés par un désir d’ouverture au monde, veulent s’exprimer et expérimenter. Ils veulent se faire entendre, être écoutés et parfois contestent. Avec la poussée de la culture postmoderne, qui favorise le pluralisme, le refus de l’autorité et de tout ce qui est institutionnel, il devient de plus en plus difficile aux responsables d’Église de trouver des stratégies adaptées à cette génération.
Les étudiants sont de plus en plus portés sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ces technologies ont changé profondément leurs habitudes. Elles affectent la façon de communiquer. Les réseaux sociaux, par exemple, ont conféré aux étudiants une impressionnante aptitude à communiquer et à s’organiser. Ces nouvelles technologies affectent leur façon d’apprendre. Le visuel prend une place de plus en plus grande. Aux États-Unis, beaucoup d’étudiants finissent leurs études universitaires sans avoir lu un livre imprimé du début à la fin. Les nouvelles technologies permettent également de déplacer les centres de pouvoir vers la périphérie. Même les pires dictateurs deviennent incapables de contrôler un pouvoir qui se déplace vers les campus, chez les étudiants. Il est difficile de prévoir toutes les conséquences de ces changements en cours dans la vie estudiantine. Ils auront certainement des conséquences profondes sur la société. Les évangéliques ne peuvent et ne doivent pas ignorer ces changements quand ils pensent au témoignage parmi les étudiants.
Le profil de l’étudiant d’aujourd’hui ne correspond plus tout à fait au profil traditionnel de l’étudiant résidentiel, habitant sur un campus universitaire et se consacrant exclusivement à ses études. Avec le développement de la communication virtuelle, rendue possible par le développement des nouveaux *médias, on assiste à une augmentation du nombre de personnes qui suivent les études en ligne. Cette tendance va certainement s’accroître, avec l’amélioration constante et rapide des nouvelles technologies. La maîtrise progressive de la formation virtuelle va conduire au changement de profil de l’étudiant. Ces changements vont certainement amener de profonds bouleversements dans les stratégies et méthodes d’évangélisation.
L’étudiant actuel est soumis à des pressions énormes, qui sont de diverses natures. Parallèlement à ses études, il doit bien souvent travailler pour son financement. Dans les pays du Sud, très peu bénéficient de bourses d’études. Ils ne peuvent pas bénéficier non plus des prêts bancaires. Nombre d’entre eux viennent de familles pauvres. Les infrastructures d’accueil étant limitées, beaucoup doivent loger loin de l’université, et donc payer plus cher leur logement. Cela réduit encore plus le temps dont ils disposent et l’attention qu’ils peuvent prêter à l’écoute de la Parole de Dieu. Le fait de vivre hors du campus les soustrait à la possibilité de vivre dans une communauté estudiantine. Toutes ces nouvelles réalités exigent des approches nouvelles nécessitant de l’imagination et de la créativité.
Ces quelques défis ne doivent pas faire reculer l’Église face à sa responsabilité missionnaire en milieu étudiant. Par un travail continu et par la prière, en mettant leurs ressources en commun et grâce à une collaboration avec les ministères spécialisés qui existent, les protestants évangéliques peuvent faire progresser l’évangélisation des étudiants.
L’evangelisation des etudiants : une tache immense
Concernant l’approche, il n’existe pas de méthode magique d’évangélisation des étudiants. La culture des étudiants change très rapidement. Une approche valable aujourd’hui sera obsolète quelque temps après. Les stratégies et méthodes se doivent donc d’évoluer constamment, en tenant compte des changements. Même si le message central reste le même, la façon de le présenter aux étudiants doit changer. C’est pourquoi l’évangélisation des étudiants exige beaucoup de créativité et d’innovation.
D’une manière générale, la meilleure stratégie est celle qui consiste à faire en sorte que l’évangélisation des étudiants soit faite par les étudiants eux-mêmes. C’est pourquoi les étudiants chrétiens doivent être les premiers acteurs de l’évangélisation de leurs amis non chrétiens. Ils vivent ensemble, développent des amitiés, discutent et argumentent. Les étudiants chrétiens font surtout l’expérience irremplaçable du témoignage de vie concrète en s’ouvrant à leurs amis non chrétiens comme des bibles ouvertes. De nombreux témoignages de conversion d’étudiants soulignent à merveille l’importance du témoignage de vie et de l’amitié des chrétiens. Le témoignage de vie produit davantage de résultat qu’une *prédication publique isolée et désincarnée. Les interventions extérieures doivent être limitées à l’encadrement et à la formation des étudiants chrétiens et à leur ressourcement. Le rôle des responsables d’Églises et autres ministres devrait être limité à la formation des étudiants, au soutien par la prière et à l’encouragement à l’action. Tous les groupes et ministères spécialisés qui ont eu une présence significative et un impact profond à l’université sont ceux qui ont compris et adopté ce principe d’évangélisation des étudiants par les étudiants.
Les professeurs et chercheurs chrétiens travaillant à l’université doivent être mis à contribution dans l’encadrement des étudiants. Vivant avec les étudiants, respectés pour leur compétence académique, ils sont respectés par tous les étudiants (y compris les noncroyants). Plusieurs étudiants non chrétiens ont été touchés par le témoignage de tels professeurs et se sont convertis. Au niveau de l’apologétique et de l’argumentation, ils aident à débattre des sujets difficiles, y compris avec leurs collègues opposés à la foi. Leur présence sur le campus offre une certaine sécurité aux étudiants chrétiens, qui peuvent parfois se sentir malmenés par des idées radicalement opposées à leur foi. En tant que points de référence, ils encourageront les étudiants chrétiens à tenir bon et à ne pas avoir peur ou honte de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Beaucoup reste à faire dans le domaine de l’évangélisation des étudiants. La tâche demande des compétences et des ressources immenses et variées. Aucun être humain, aucun groupe d’individus, aucune dénomination ne peut l’accomplir seul. Seul Dieu peut le faire. Il est à l’oeuvre, ouvrant des portes et des fenêtres, créant des occasions parfois insoupçonnées et inattendues. C’est lui qui invite à se joindre à la mission. Contribuer à l’évangélisation des étudiants est un privilège que Dieu donne de prendre part à ce qu’il est déjà en train de faire. Ce privilège de travailler avec Dieu incite à l’humilité, à la collaboration avec les autres. Il doit aussi encourager à ne pas désespérer face aux difficultés, car l’oeuvre lui appartient.
Bibliography
Solomon Andria, Regard théologique sur l’éducation en Afrique contemporaine, Cotonou, Groupes bibliques universitaires d’Afrique francophone, 1998.
Lindsay Brown, Shining Like Stars. The Power of the Gospel in the World’s Universities, Leicester, IVP, 2007.
Collectif, Mutation de la jeunesse étudiante et hésitation à l’égard du christianisme, Lumière et Vie 232, 1997.